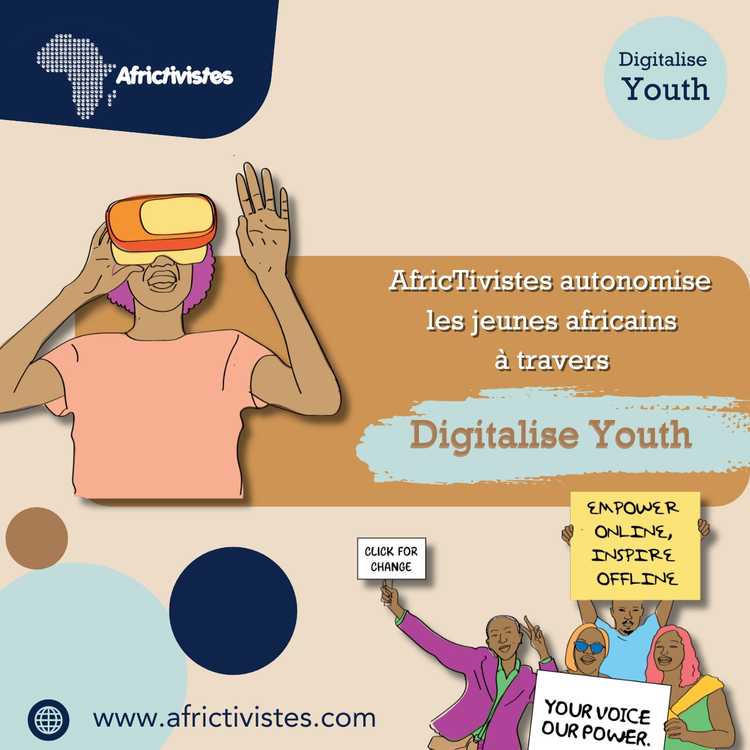Défi de la sacralité de la limitation des mandats en Afrique: entre pouvoirisme et illusion démocratique
Le troisième mandat a toujours été un enjeu majeur sur le continent. Au lendemain des indépendances, de nombreux États africains ont adopté des régimes très forts prétextant le besoin de préservation de la cohésion sociale et le développement économique. Cette conception du pouvoir politique freinait toute tentative d’ouverture démocratique. La limitation du nombre de mandats était pratiquement inexistante de droit/ de fait dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne et le système politique était fortement caractérisé par le monopartisme de droit / fait.
C’est à la suite de la crise institutionnelle de décembre 1962, que le Sénégal adopte la Constitution du 7 novembre 1963 qui instaure un rétrécissement de l’espace civique, un régime répressif et hyper présidentialiste et un système de parti (1966 – 1974). Un qualificatif de parti unique que récusait systématiquement Léopold Sédar SENGHOR qui préférait parler de système de « parti unifié ».
En 1974, le Sénégal procède à une ouverture démocratique avec la reconnaissance du PDS de Me Abdoulaye WADE. Avec la loi n°76-01 du 19 mars 1976, l’Etat prône le tripartisme autour des trois idéologies suivantes : le socialisme (Parti Socialiste – PS de Léopold Sédar SENGHOR), le libéralisme (Parti Démocratique Sénégalais – PDS de Me Abdoulaye WADE) et le communisme (Parti Africain pour l’Indépendance – PAI de Majhemout DIOP). La loi n°78-60 du 28 décembre 1978 a élargi le champ des partis politiques à quatre avec la reconnaissance d’un quatrième parti politique incarnant l’idéologie conservatrice dévolue au Mouvement Républicain Sénégalais (MRS) de Me Boubacar GUEYE. En 1981, Abdou DIOUF, arrivé au pouvoir par le truchement de l’article 35 de la Constitution, consacre le système de multipartisme intégral avec la loi 81-17 du 6 mai 1981.
Le multipartisme au Sénégal intervient dans une période où l’essentiel des pays africains vivent sous la domination du système monopartite. Ils ont commencé à expérimenter le pluralisme démocratique à partir des années 1990 avec ce qu’il est convenu de qualifier de renouveau du constitutionnalisme africain. Le régime de Félix Houphouët BOIGNY, en Côte d’Ivoire, suite la pression de la rue, aux conséquences sociales des politiques d’ajustement structurel et à la troisième vague de démocratisation pour reprendre Samuel Huntington (1991), reconnut officiellement le FPI (1990), mettant ainsi fin à sa clandestinité. Houphouët BOIGNY créa un poste de Premier Ministre qu’il confia à Alassane Dramane OUATTARA (1991). De nombreux pays d’Afrique subsaharienne s’adonnèrent à cet exercice d’ouverture démocratique tantôt suite à des conférences nationales tantôt suite à ce qu’on pourrait appeler une démocratisation par graduation. Ce bond qualitatif démocratique se caractérisait aussi par l’introduction dans les Constitutions nouvellement adoptées ou révisées d’une disposition limitant le nombre de mandat présidentiel. Cette ouverture démocratique donna de l’espoir démocratique et augurait la survenue d’alternances politiques. Malheureusement, cet espoir démocratique de limitation des mandats a vite cédé la place à un désespoir démocratique. Déjà en 1997, le président Blaise COMPAORE du Burkina Faso déverrouille la disposition de limitation du nombre de mandats présidentiels.
Ce rétropédalage de Blaise COMPAORE pourrait être assimilé à une boîte de Pandore tellement qu’il fera tache d’huile auprès de beaucoup de ses homologues d’Afrique subsaharienne. Les tripatouillages constitutionnels étaient devenus un jeu d’enfant au gré des désidérata du prince. Dans certains pays comme le Sénégal, nous avons assisté à un yo-yo constitutionnel entre la limitation et la non-limitation du nombre de mandats (suppression de la limitation du nombre de mandats en 1998 et sa restauration en 2001).
Considérant la volte-face constitutionnelle sur la limitation du nombre des mandats dans certains pays et la présidence viagère de fait dans d’autres, cette subite bonne foi démocratique n’était, à l’analyse des faits, qu’une esthétique démocratique. L’alternance demeure dans des pays comme Togo, le Cameroun, le Rwanda, l’Ouganda un mirage démocratique.
Néanmoins, aux côtés de ces mauvais élèves de la démocratie, il convient de souligner les efforts de normalisation du jeu démocratique et électoral des pays comme le Ghana, le Cap Vert, le Botswana, le Sénégal, entre autres.
Certains de ces « bons élèves » de la démocratie font parfois face à des soubresauts – susceptibles – de remettre en cause leur bonne réputation démocratique et électorale.
Le constat est que la problématique de la non limitation des mandats à deux (02) demeure un élément déterminant dans la rupture à la paix sociale et politique dans de nombreux pays. L’agitation de la question du troisième mandat soulève des passions et des violences engendrant parfois des cas de décès, des destructions de biens publics et privés et paralysant l’économie du pays.
Au Sénégal, le flou longtemps maintenu par le président Macky Sall sur sa troisième candidature a exacerbé la tension politique et constitué un terrain fertile aux manifestations sociopolitiques de 2021 à 2024, faisant de cette période l’une des pages les plus agitées de l’histoire politique du pays.
En 2012, une nouvelle forme de d’activisme a vu le jour avec l’avènement d’internet, des plateformes de réseaux sociaux et les technologies civiques (Civic Tech). Les Présidents africains tentés par le syndrome du non-respect de la limitation des mandats font face à une société civile 2.0 qui, par la force du clavier et des idées, fait savoir au monde, dans l’instantanéité, entier ce qui se passe dans leur pays.
La journée du 3 février 2023 restera comme une manifestation de cette force des plateformes numériques. Ce jour, à travers une déclaration solennelle, le président Macky Sall reporte l’élection présidentielle. L’allocution du président. a suffi pour faire remonter le hashtag #FreeSenegal (créée en 2021) dans les tendances des utilisateurs sur X (anciennement Twitter). Le hashtag « en majeure partie couplé au terme “coup d’État” », a enregistré 20 000 tweets à la mi-journée selon le site Afrique Connectées. Vingt-quatre heures plus tard, c’est plus de plus de 200 000 tweets. Et ce, malgré l’annonce de la coupure du réseau internet mobile à la demande des autorités, après les heurts provoqués par l’annonce du président de la république, Macky Sall.
Dans ce contexte, AfricTivistes a lancé, en février 2024, le projet Sénégal : Un pouvoir, Deux mandats, qui encourage à préserver les acquis démocratiques à travers le respect de la limitation des mandats, la libération et à la sécurisation de l’espace civique. Le projet s’articule entre autres autour d’un film documentaire éponyme, un livre blanc sur la limitation des mandats et une veille légale pour l’indépendance de la justice et la protection des droits fondamentaux au Sénégal.
Un vibrant pour plaidoyer en faveur de la démocratie, de la transparence et de la responsabilité des dirigeants, visant à mobiliser la société civile et à sensibiliser les citoyens sur l’importance du respect des institutions et des normes démocratiques.

![[Tanzanie] : AfricTivistes dénonce les arrestations arbitraires et exige la libération sans condition des activistes pro-démocratie !](/static/a44afee108f522754a9bdbd0b5a2ebbe/9e635/Communique-tanzanie-.jpg)

![[Guinée-Bissau] : Bubacar Turé, président de la LGDH, dans le viseur des autorités !](/static/91b946ab31a2788bd41858667d8f8380/fce2a/francais-1.png)
![[Burkina Faso] Obstruction de l’espace civique](/static/abee3026b3cabf963d1adbda451a4393/9e635/WhatsApp-Image-2025-04-11-at-19.12.13.jpg)




![[Sénégal] Abrogation ou interprétation de la loi d’amnistie, AfricTivistes appelle au respect des engagements pris !](/static/94d5667e5bf8a1fad5a7a67003e8831d/fce2a/FR-1-1.png)
![[Guinée Bissau] Des organisations de la société civile d’Afrique de l’ouest dénoncent les tripatouillages constitutionnels et alertent sur la crise politique](/static/25e52ff4dd927f6f40951f11f84765e6/9e635/WhatsApp-Image-2025-03-17-at-20.19.20.jpg)